Quelques secondes avant que je le filme, cet homme me souriait et avait l’air en pleine forme. Il avait suffi que j’appuie sur le bouton d’enregistrement de ma caméra vidéo pour qu’il prenne soudainement un air triste et se mette à respirer, en apparence, avec beaucoup de difficulté. Chaque inspiration semblait lui brûler les poumons. La douleur se lisait sur les plis de son front… jusqu’à ce que j’arrête de filmer et qu’il reprenne son air normal, comme par magie.
C’était à Bhopal en janvier 1985, un peu plus d’un mois après un événement qui a rendu cette petite ville indienne tristement célèbre. Un nuage de gaz toxiques échappés d’une usine de produits chimiques avait exterminé en quelques minutes plusieurs milliers d’habitants du bidonville adjacent surpris dans leur sommeil, une chambre à gaz à ciel ouvert, la solution finale de leur vie de misère, avec dans le mauvais rôle la Union Carbide, une richissime multinationale américaine propriétaire de l’usine (en savoir plus).
En apparence, il y avait de la matière pour Le Grand Raid, le concours journalistique auquel je participais. Surprise en arrivant sur place: aucun signe visible d’une tragédie quelconque. Les morts avaient été incinérés ainsi que les carcasses d’animaux. En surface, la vie suivait son cours. Comment faire rapidement (je n’avais que deux jours) un reportage télé sans images?
L’info-spectacle et le mélange des genres
Alors que je ne trouvais rien d’autre à filmer que des dizaines d’enfants qui me poursuivaient partout avec de larges sourires et des cris de joie, cet homme, assis devant sa cabane de branches et de sacs de plastique, avait insisté pour que je m’approche en faisant de grands signes de la main. Il me paraissait sans véritable intérêt pour mon film jusqu’à ce que j’installe ma caméra vidéo sur trépied et que j’appuie sur le bouton de démarrage.
 Même dans ce coin reculé d’Asie, dans les jours et les semaines qui avaient suivi la catastrophe, suite au défilement de centaines de journalistes venus de partout, ce vieil homme probablement analphabète avait compris le pouvoir des médias internationaux et l’influence qu’ils pouvaient avoir sur sa situation. Et il en jouait.
Même dans ce coin reculé d’Asie, dans les jours et les semaines qui avaient suivi la catastrophe, suite au défilement de centaines de journalistes venus de partout, ce vieil homme probablement analphabète avait compris le pouvoir des médias internationaux et l’influence qu’ils pouvaient avoir sur sa situation. Et il en jouait.
Je ne doute pas qu’il ait eu de réels problèmes de santé. Comment aurait-il pu en être autrement alors qu’il vivait à quelques mètres de l’usine? Mais il en rajoutait et, malgré la barrière de la langue, m’offrait un pacte tacite: il me livrait ce que j’attendais en retour de quoi il espérait que mes images émeuvent quelque part des gens qui avaient de l’influence sur l’aide qui lui serait apportée.
Je me suis souvent rappelé cette rencontre dont tout ce qu’il me restait était cette image de misère furtive d’un petit film larmoyant, à peine retenue au montage, sans aucune mise en perspective ni commentaire. Je ne savais pas trop quoi en retenir. Devais-je être choqué ou amusé que cet homme ait appris à manipuler les médias? Où allait le monde si on ne pouvait même plus faire confiance à ces bons grand-pères du Tiers-Monde?…
En fait, j’étais consentant à être manipulé par lui et serais bien mal placé pour le blâmer. J’ai utilisé sa séquence dans mon film (un des plus mauvais reportages de ma petite carrière) ainsi que d’autres images de misère qui, finalement, n’ont pas été difficiles à trouver (distribution de médicaments, orphelins, malades des yeux). Même avec mes idéaux de journaliste en herbe, je croyais que, pour la bonne cause, j’avais besoin de cette séquence. Et après tout, me disais-je pour me rassurer, nous étions à égalité: il contrôlait son image et je contrôlais mon sujet.
 La vérité est que je n’ai pas fait mon travail de journaliste. Je ne sais même pas qui il était et ce qu’il vivait. Mon reportage, qui n’apportait strictement rien de nouveau, n’aura servi qu’à perpétuer cette idée que les Occidentaux se font des habitants des pays pauvres, ces éternels assistés toujours victimes de quelque chose, comme si cela faisait partie de leur normalité. C’est ça l’info-spectacle: des images réductrices qui jouent presque exclusivement sur les ressorts de l’émotion, avec l’effet pervers que pour émouvoir, il faut des catastrophes toujours plus catastrophiques, une misère toujours plus abjecte, des images toujours plus exotiques.
La vérité est que je n’ai pas fait mon travail de journaliste. Je ne sais même pas qui il était et ce qu’il vivait. Mon reportage, qui n’apportait strictement rien de nouveau, n’aura servi qu’à perpétuer cette idée que les Occidentaux se font des habitants des pays pauvres, ces éternels assistés toujours victimes de quelque chose, comme si cela faisait partie de leur normalité. C’est ça l’info-spectacle: des images réductrices qui jouent presque exclusivement sur les ressorts de l’émotion, avec l’effet pervers que pour émouvoir, il faut des catastrophes toujours plus catastrophiques, une misère toujours plus abjecte, des images toujours plus exotiques.
Aujourd’hui, ces images arrivent au bout de leur logique. Les bonnes vieilles recettes ne marchent plus. A l’heure de l’Internet omniprésent, des bouquets satellitaires de chaînes télé par milliers, des tabloïds gratuits, ceux qui collectivement pourraient avoir de l’influence sur la construction d’un monde plus humain, ont déjà tout vu. Gavés d’images de détresse, baignés dans la soupe des bons sentiments, mitraillés par Twitter, ils saturent, de plus en plus insensibles à la surenchère médiatique.
Le problème, je crois, vient en bonne partie du fait que le Tiers-Monde ne participe pas à la construction de son image, qu’il n’y a pas de contrepartie au pouvoir démesuré des médias occidentaux de dépeindre les réalités des pays pauvres comme ils l’entendent. C’est trop de pouvoir par rapport à leur capacité à en user de manière responsable.
Grand-pères du Tiers-Monde et adolescents de Facebook: même combat
Dans le cadre de mon travail, j’ai dû convaincre des milliers de personnes de se laisser photographier ou interviewer par moi. C’est un aspect assez particulier du métier de journaliste ou de communiquant: devoir rapidement gagner la confiance d’inconnus pour qu’ils vous livrent leur « histoire » et, par votre biais, ouvrent leur intimité au regard de milliers d’inconnus, sans réelle garantie sur la manière dont vous présenterez cette histoire.
Quand, de plus, on travaille à l' »international », avec des gens qui ne parlent pas votre langue et qui vivent très loin de votre culture et de vos références, des gens souvent peu éduqués et modestes, parfois fragiles ou vulnérables, il faut simplifier les explications à l’extrême: leurs paroles et leur image seront utilisées à leur profit, publiées avec l’espoir qu’elles sensibilisent les décideurs à leur situation, quelque part à l’autre bout du monde. « Non, vous n’en verrez pas de résultat direct et immédiat mais c’est pour votre bien, croyez-moi. » Une fois ces paroles réconfortantes traduites, la plupart du temps par un accompagnateur qui est une figure d’autorité pour eux, comme un employé d’ONG ou de ministère qui leur procure des soins ou une autre forme d’aide (raison pour laquelle cette personne accompagne le journaliste), la réponse est pratiquement toujours positive. Ils sont flattés que quelqu’un s’intéresse à eux. Et surtout, on ne mord pas la main qui nous nourrit…
 Ces gens sont-ils vraiment consentants à ce que leurs problèmes personnels soient étalés comme ils le sont sur la place publique? En ce qui me concerne, je prends le temps d’expliquer qui je suis et ce que je compte faire des images mais, par exemple, comment expliquer Internet à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ou ne l’a jamais utilisé? Devrais-je m’abstenir de prendre la photo de quelqu’un qui ne comprend peut-être pas toutes les implications que son image devienne publique, même si cette personne majeure et saine d’esprit accepte en apparence?
Ces gens sont-ils vraiment consentants à ce que leurs problèmes personnels soient étalés comme ils le sont sur la place publique? En ce qui me concerne, je prends le temps d’expliquer qui je suis et ce que je compte faire des images mais, par exemple, comment expliquer Internet à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ou ne l’a jamais utilisé? Devrais-je m’abstenir de prendre la photo de quelqu’un qui ne comprend peut-être pas toutes les implications que son image devienne publique, même si cette personne majeure et saine d’esprit accepte en apparence?
Je suis souvent surpris par l’incroyable facilité avec laquelle ces gens m’accordent leur confiance. Ils me font penser à tous ces « natifs d’Internet », pourtant éduqués, qui livrent leur intimité à Facebook et autres réseaux avec la même candeur, la même innocence et la même insouciance. Dans les deux cas, en se laissant photographier ou en cliquant sur un lien de mentions légales interminables et illisibles, ils perdent tout contrôle sur l’utilisation qui sera faite de leur image. Face à des interlocuteurs insaisissables, la presse étrangère d’un côté, l’Internet de l’autre, c’est un combat inégal. Leur consentement réel a peu d’importance et ils ne sont pas armés pour dire non.
Droit à l’image – Droit de regard
Nous sommes une société de l’image: sans elle, pas de communication, et sans communication, pas de changement. La solution n’est pas de ne pas photographier. Mais il y a peut-être moyen de le faire autrement.
 Comme cette ONG, PhotoVoice, entièrement consacrée à la « photo participative »: on distribue des appareils photos à des réfugiés, par exemple, on leur donne une formation de quelques heures sur l’utilisation de l’appareil, la composition de leurs photos et les questions éthiques entourant la représentation de leur quotidien en images, et on les laisse documenter leur vie comme ils la voient (un article en français sur ce sujet, La photographie participative « Regards d’eux, histoire d’oeil »).
Comme cette ONG, PhotoVoice, entièrement consacrée à la « photo participative »: on distribue des appareils photos à des réfugiés, par exemple, on leur donne une formation de quelques heures sur l’utilisation de l’appareil, la composition de leurs photos et les questions éthiques entourant la représentation de leur quotidien en images, et on les laisse documenter leur vie comme ils la voient (un article en français sur ce sujet, La photographie participative « Regards d’eux, histoire d’oeil »).
Est-il besoin d’ajouter que les résultats sont différents de ce qui est étalé dans les tabloïds gratuits du métro? Des photos qui ne cherchent pas le sensationnel ou l’esthétisme, qui montrent des gens qui ne se résument pas à la somme de leurs problèmes, des humains plus proches de nous qu’on pourrait l’imaginer.
Personnellement, je suis beaucoup plus sensible à ce genre d’histoires et je m’identifie bien plus facilement à quelqu’un qui me ressemble qu’à un oiseau exotique des antipodes. Et je crois que je ne suis pas seul, que beaucoup de gens comme moi, pour ressentir cette proximité qui leur donne envie d’exprimer leur solidarité, ont besoin que l’émotion brute et éphémère fasse place à une meilleure compréhension des réalités du Tiers-Monde.
Ceci passera peut-être par des initiatives d’éducation aux médias comme PhotoVoice, par une évolution du traitement médiatique des pays du « Sud » dans les pays du « Nord » (voir Africascopie, l’Afrique dans la révolution numérique, un exemple remarquable de web-reportage participatif) ou par la mise en relation directe d’hommes et de femmes de ces pays par Internet et ses réseaux sociaux. Peu importe, du moment qu’on trouve le moyen de mettre fin à cette logique médiatique sans issue.
Sans aller jusqu’à souhaiter qu’ils jouent la comédie comme mon grand-père de Bhopal, je rêve que des millions d’hommes et de femmes comme lui apprennent à faire preuve du même discernement, à contrôler comment leur vie est représentée dans les médias, à établir un meilleur rapport d’égalité avec ceux qui ont la responsabilité de construire et projeter leur image dans les pays riches, pour créer un plus juste équilibre dans le jeu des médias et dans la fabrication de l’image du Tiers-Monde, pour qu’on parle de ces hommes et de ces femmes autrement qu’en termes d’éternels assistés ou d’objets de curiosité qui nous divertissent et qui nous rassurent sur notre supériorité.
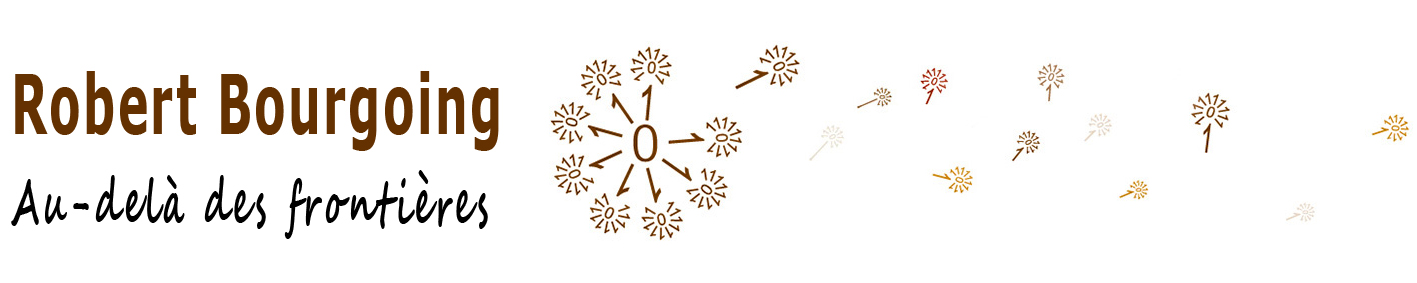



Pour ma part, ayant voyagé un peu, j’ai toujours été touchée en plein coeur, des regards croisés, des sourires, parfois d’un Geste.
Tant et tant de différences, et pourtant la vie intérieure, gorgée d’espoir, de partage et … que de générosité chez les plus démunis qui permet, en ces jours, de réaliser oh combien de fait d’avoir est moindre que le fait d’être … ensemble … entre Humains et Humaines 😉
C’est très intéressant ta réflexion sur cette image, galvaudée parce que construite par des regards occidentaux. Et c’est vrai qu’à force, on engrange des poncifs sur le tiers monde et on recherche ça lorsqu’on voyage et on photographie ce qu’on a déjà imprimé dans nos cerveaux. Les photos que peuvent prendre les autochtones doivent être bien différentes et bien plus vivantes que ces « icônes du malheur ».
Un développement plus ample aurait lassé. Quant à l’adaptation par les gens du « Tiers Monde » de leur image projetée dans les media de l’Occident, cette anacdote est éloquente. Et pour la solution, je crois que tu es dans le vrai: la situation sera plus saine le jour où l’autre partie du monde secouera notre monopole. D’ailleurs l’Inde (mais est-elle encore un pays du Tiers Monde?) d’ores et déjà en a les moyens techniques sinon la volonté. Et quid d’Al Jazeera?